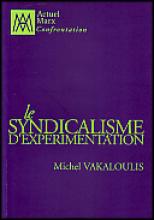
Introduction Première partie : Capitalisme d’entreprise et troubles syndicaux
Chapitre Premier : La perpétuelle réforme de l’entreprise
Chapitre II : La communication patronale au poste de commandement
Chapitre III : Luttes symboliques et stratégies syndicales
Chapitre IV : Le pari de la mobilisation collective
Deuxième partie : Les carrefours de la reconquête
Chapitre V : Puissances et faiblesses de l’acteur syndical
Chapitre VI : Chantiers du renouveau
Chapitre VII : Un avenir exigeant
Conclusion : Le nouvel esprit du syndicalisme
Bibliographie
Introduction
Cet ouvrage est un témoignage politique et une réflexion critique sur un monde largement méconnu : le syndicalisme salarié. Son objectif est de traiter la vie syndicale comme sujet d’investigation de fond. Le choix de ce thème n’est pas fortuit, mais prolonge des travaux sociologiques précédents sur la dynamique de l’action collective dans la France contemporaine. L’effort de l’analyse vise à construire des repères et des cohérences pour mieux concevoir les modes d’action et de représentation des salariés confrontés à la profonde transformation du capitalisme d’entreprise.
Selon notre hypothèse initiale, le syndicalisme constitue une véritable affaire de société. En tant qu’outil de libertés, d’échanges, d’information et d’épanouissement individuel, il imprègne l’ordre productif moderne et marque le renouveau démocratique de l’espace public. Il est de la sorte trop « précieux » pour être le souci exclusif d’appareils spécialisés ou la préoccupation incommodante de dispositifs managériaux : c’est une affaire qui concerne aussi bien le « monde des militants » que les salariés non syndiqués et les citoyens « ordinaires ».
La confrontation du chercheur à l’univers syndical se révèle instructive à double titre. D’une part, elle permet de réhabiliter, à travers un long travail de description et d’interprétation, des pratiques contestataires habituellement dévalorisées ou méprisées. De rendre familier un phénomène social réputé « déclinant », « vieilli », « impraticable ». D’autre part, elle suscite une interrogation proprement théorique sur la recomposition du travail salarié, les limites des formes traditionnelles de protestation, les potentialités entravées du « mouvement social » dont le syndicalisme est une composante fondamentale.
La rencontre avec cette réalité empirique engendre aussi le besoin de revisiter certains raccourcis d’interprétation dont l’invocation rituelle par les discours médiatiques et politiques renforce la méconnaissance des phénomènes qu’il s’agit d’observer. À ce titre, la thématique de la « crise du syndicalisme » est symptomatique. Largement débattue au cours des années 1990, elle s’est imposée avec la force d’une « évidence » : au vu de la chute vertigineuse de ses adhérents et de sa segmentation institutionnelle, le syndicalisme serait un « grand malade ». Son « déclin » connoterait le passage d’une société structurée par la confrontation de classe à une « société de communication » basée sur l’échange d’informations entre individus atomisés. C’est là le récit d’une obsolescence postulée, et simultanément, la prédiction d’une nouvelle ère, moins conflictuelle et plus interactive.
Or, l’analyse des difficultés actuelles du syndicalisme et la recherche des voies de son renouvellement renvoient à plusieurs questions entrelacées que le chercheur ne saurait traiter sans défaire l’unité présupposée de tels diagnostics simplistes. La « crise » de la forme syndicale n’est sans doute pas un leurre. Mais son énonciation ne peut pas tenir lieu de descriptif satisfaisant ni fonder des conjectures sur l’avenir du syndicalisme. Si elle a le mérite de pointer le curseur sur des impasses et des carences réelles, elle risque aussi d’occulter le travail de réinvention syndicale.
La portée de ces interrogations est fondamentalement pratique. Elle concerne l’efficacité du syndicalisme. Sa capacité d’articuler revendications immédiates et combat pour l’élargissement des avancées sociales. Son inscription dans une logique offensive contre les stratégies du libéralisme qui déstabilisent depuis deux décennies le monde du travail. Il y va de l’avenir du syndicalisme de conquêtes dans son principe même.
Le régime économique dans lequel évolue aujourd’hui le syndicalisme salarié est fondé sur la flexibilité du travail et la précarisation massive de l’emploi. L’entreprise se trouve en perpétuelle réforme de structures qui implique le morcellement ou le démantèlement des anciens collectifs de travailleurs. La priorité des directions est désormais la création de valeur actionnariale au détriment de l’emploi et des conditions de travail. Le rapport salarial keynésiano-fordiste (caractéristique des Trente Glorieuses) est sérieusement ébranlé par le développement des politiques de dérégulation et la multiplication des contrats de travail précaires. Les identités et les préoccupations professionnelles demeurent fortes, mais en règle générale, le rapport au travail est loin d’être source d’épanouissement individuel. Au contraire, il est le plus souvent vécu par les salariés comme une souffrance physique et psychologique, comme une mise à l’épreuve stressante. Et pour cause : la rentabilité capitaliste passe avant la santé et le bien-être des femmes et des hommes. La logique financière « surplombe » celle du métier, de la maîtrise du temps, du dévouement à une « communauté » d’objectifs et d’intérêts partagés.
Parallèlement, les stratégies patronales de mobilisation des salariés visent à contourner les mécanismes de la représentation syndicale. Rationalisation managériale du travail et désamorçage préventif des résistances, spontanées ou organisées, des travailleurs sont inséparables. Le recours à des « outils-miracles » du management moderniste et à des méthodes de communication s’avère massif, persévérant, onéreux. Le pouvoir patronal dans l’entreprise s’appuie sur des technologies de contrôle comme la segmentation, l’individualisation, la désincitation à l’action collective par crainte de la sanction, de l’échec personnel, du licenciement abusif. Il s’agit de saper les bases et les moyens d’action traditionnels du syndicalisme, de court-circuiter la médiation des délégués du personnel, de déplacer le terrain de la conflictualité vers des emplacements en retrait de l’action directe des travailleurs.
L’action syndicale se trouve ainsi confrontée à des défis majeurs, sinon inédits. L’efficacité et le suivi du travail syndical, la répartition des tâches et des ressources nécessaires à leur accomplissement dépendent considérablement de la capacité de débattre collectivement les problèmes, de faire circuler l’information, voire de la produire à travers une confrontation plurielle. La qualité des échanges sociaux dans la vie syndicale, en particulier leur dimension « communicationnelle », acquiert une importance décisive pour la construction du projet syndical. La question de la démocratie syndicale, la valorisation de l’apport individuel dans le travail de la mise en commun, l’ouverture à de nouvelles thématiques et formes de lutte, notamment symboliques, sont des défis auxquels le syndicalisme ne saurait se soustraire sous peine de manquer son propre renouveau.
Le point d’entrée de notre étude est la question de la « communication syndicale ». C’est là un aspect distinct et facilement identifiable de l’action syndicale. Les militants nouent des contacts et échangent des informations avec les salariés, écrivent et distribuent des tracts, négocient avec les directions managériales. Ils utilisent des techniques de diffusion de leurs idées et de leurs propositions. Ils se préoccupent de l’audience de leur organisation et s’investissent pour élargir son influence. De toute évidence, « ils communiquent ». Cette activité représente un vaste champ de créativité et d’expérimentation syndicales. Son contenu semble éclatant, voire transparent.
Il n’empêche que l’étendue de la communication syndicale est insuffisamment délimitée. Quels sont ses lieux d’exercice, ses valeurs et croyances pratiques ? Comment évaluer son rôle et mesurer son efficacité ordinaire ? La solution de facilité serait de confondre la communication syndicale avec l’activité syndicale dans son ensemble. Mais cette démarche analytique est problématique dans la mesure où elle fait d’une dimension déterminée du syndicalisme sa substance même. Or, il est aussi erroné de promouvoir une vision « communicationnelle » du syndicalisme qu’une vision « informationnelle » de l’homme. Sans évoquer les conséquences politiques d’une telle posture qui ramènerait le combat syndical à une compétition cognitive tempérée, dépourvue de fondement antagonique.
La question de la communication syndicale est donc d’une approche malaisée. Les difficultés sont de trois ordres. En premier lieu, elles relèvent de la charge symbolique du terme « communication » qui se prête à des usages contrastés. Paradoxalement, cette polysémie semble fonder la force d’attraction du terme. Plusieurs interrogations peuvent être formulées à cette occasion. La « communication » est-elle une dimension caractéristique de toute activité sociale ? Connote-t-elle un changement d’ère historique, une rupture de civilisation ? Renvoie-t-elle à une domestication de l’antagonisme de classe au profit des processus sociaux plus « délibératifs » ? Il en résulte un effet de brouillage terminologique qui consiste à projeter sur une dimension spécifique de l’action syndicale des problématiques et des représentations sociales plus vastes.
En deuxième lieu, l’appellation « communication syndicale » est profondément ambiguë dans la mesure où elle laisse entendre qu’une partie du travail militant échappe à des considérations politiques (au sens large du terme), pour devenir une affaire « technique ». C’est-à-dire une simple gestion des flux d’informations, de messages et de propositions que le syndicalisme produit, diffuse et utilise de manière régulière. C’est là une vision conventionnelle et dépolitisante de la communication syndicale qui accrédite la croyance en l’efficacité des déterminismes technologiques.
En troisième lieu, la fonctionnalité de la communication syndicale n’est pas à comprendre comme si cette dernière était une entité détachée de la vie syndicale d’ensemble. En effet, elle ne peut pas être étudiée dans son autonomie idéalisée, en faisant l’impasse sur les formes, les contenus, les objectifs du syndicalisme et les contraintes dans lesquelles sont pris les acteurs syndicaux. L’illusion de séparabilité d’un aspect de l’activité syndicale défini par le biais de sa technicité propre conforte une image « post-moderne » du syndicalisme : sa consistance interne est introuvable. Celui-ci ne représente plus un fait social total mais un cartel de dispositions et de dimensions expressives combinables et recomposables à l’instar d’un puzzle.
Qu’en est-il donc de la communication syndicale ? Nous proposons de la concevoir, provisoirement, comme l’ensemble des interactions et des échanges sociaux qui se nouent autour de la défense organisée des intérêts matériels et moraux des travailleurs et qui visent la production, la circulation et l’utilisation de ressources symboliques en vue des objectifs de l’activité syndicale. Si elle s’appuie sur des techniques, des supports matériels et des dispositifs de mise en commun des flux symboliques, son contenu ne renvoie pas moins à des échanges intersubjectifs intenses où la dimension « politique » (c’est-à-dire idéologique, revendicative, corporative, etc.) et la dimension « relationnelle » (les valeurs et les croyances partagées, la camaraderie, les affinités personnelles, etc.) font bloc et souvent se confondent.
Trois aires de communication syndicale peuvent être schématiquement dégagées : les interactions syndicales « internes », les relations entre syndiqués et non-syndiqués, le jeu contradictoire entre communication patronale et communication syndicale. Ces aires sont sous tension permanente et produisent des effets cumulés de la plus grande importance pour l’impulsion de l’action collective des travailleurs.
Comment la communication interne des équipes syndicales influe-t-elle sur son « dehors » ? De quelle façon la structure syndicale s’ouvre-t-elle aux expériences et aux exigences des non syndiqués ? Par quels procédés fait-elle remonter en son sein les attitudes et les attentes de ces derniers ? Quelles sont les habitudes politiques et mentales qui pèsent sur les modes d’expression des militants syndicaux et quelle est la part de l’innovation dans la mise en œuvre des stratégies de mobilisation ? La réponse à ces problèmes admet assurément des variations, compte tenu de l’hétérogénéité des situations concrètes et des dissymétries dans la structuration syndicale du salariat. Les éléments de synthèse que nous proposons dans cette étude n’ont rien de définitif ou de « totalisant » : ce sont des matériaux construits à partir de notre expérience d’« immersion » dans l’activité syndicale quotidienne.
170 pages
édition : novembre 2007