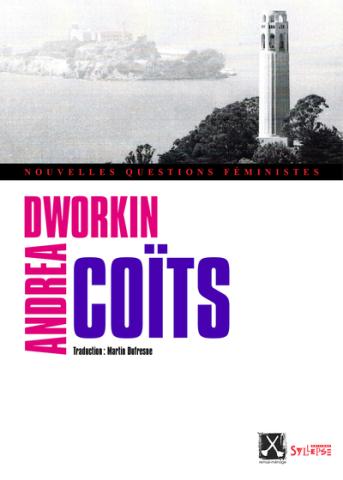
Prix
20,00 €
Quand j’ai terminé l’écriture d’Intercourse1, un collègue m’a conseillé d’y ajouter une présentation pour expliquer le contenu du livre. De cette façon, les gens ne seraient pas choqués, apeurés ou irrités, puisque les idées leur seraient déjà familières, mâchées d’avance, plus digestes ; je m’épargnerais des interprétations erronées ou malicieuses, des distorsions délibérées ; et mon empressement à montrer patte blanche attesterait de mon désir que les gens m’aiment ainsi que mon livre, quintessence d’une attitude féminine. Cela serait un genre de demi-génuflexion.
D’autres collègues – sans doute plus francs – m’ont conseillé tout de go de le publier sous un nom d’emprunt. J’ai refusé ; et Intercourse est devenu l’équivalent d’un test de Rorschach social où les gens ont lu les caricatures qu’ils imaginaient de moi et tout ce qu’ils présumaient connaître à mon sujet. D’abord édité aux États-Unis, en même temps que mon roman Ice and Fire, en 1987, Intercourse continue à être traîné dans la boue par des gens qui ne l’ont pas lu, réduit à quelques slogans par des journalistes se posant en critiques, en sages ou en grands penseurs, traité comme un écrit odieux et haineux par tous les crétins qui s’imaginent que l’apaisement de notre monde violent viendra d’encore plus de respect envers des hommes blancs et décédés.
Mes collègues avaient raison, bien sûr, mais je trouvais leurs conseils offensants. Je n’ai jamais écrit pour un auditoire timoré, passif ou stupide, comme le sont la plupart des critiques : érudits, mais analphabètes fonctionnels, membres d’un gang, d’une meute, qui commettent leurs exécutions sur papier et qui confondent la « rue » avec le monde des cocktails. « C’est ce qu’on dit dans la rue », affirment-ils, du sommet de leurs appartements-terrasses. Ce n’est pas un hasard si c’est à des journalistes blancs mâles que l’on doit la presque totalité des innombrables essais parus ces dernières années au sujet du déclin et de la chute de la culture anglo-européenne. Ils attribuent cette défaite à l’effet polluant de femmes de toutes origines raciales et de quelques hommes de couleur. Abandonnant les cinq paramètres de la déontologie journalistique (exposer « qui, quoi, où, quand et comment ») et la prose économe et masculine d’un Hemingway, ils tentent maintenant de répondre à la question « pourquoi ». Ce déclin et cette chute s’expliquent, disent-ils, parce que des femmes sans talent et sans gêne infestent aujourd’hui la littérature ; ou parce que des féministes militantes font obstacle à l’art pro-viol et pro-domination, signé par des hommes de talent vivants ou morts ; ou parce que le public multiculturel, qui tend à être féminin et non blanc, place Alice Walker et Toni Morrison au-dessus d’Aristote et du marquis de Sade. Ce à quoi je réponds : Alléluia.
Intercourse est un livre qui explore le monde sexué de la domination et de la soumission. Il procède en cercles descendants plutôt qu’en ligne droite. Comme dans un tourbillon, chaque spire plonge plus profondément dans ce monde. Son modèle formel est l’Enfer de Dante ; sa dette lyrique va à Rimbaud ; l’égalité qu’il entrevoit est ancrée dans les rêves des femmes – générations silencieuses, voix pionnières, rebelles isolées et multitudes – qui ont protesté, réclamé, hurlé, transgressé des lois, voire supplié. Ces supplications étaient un palliatif à des représailles violentes et à des ripostes physiques contre ceux qui nous exploitent et qui nous blessent. Je veux que les femmes en finissent avec les supplications.
Censurer socialement les femmes comme si nous avions la rage parce que nous parlons sans excuses du monde où nous vivons constitue une stratégie, une menace habituellement efficace. Les hommes réagissent souvent aux paroles des femmes, verbales ou écrites, comme à des actes de violence ; il leur arrive de réagir aux paroles des femmes par l’agression. Alors nous baissons la voix. Les femmes chuchotent. Les femmes demandent pardon. Les femmes se taisent. Les femmes banalisent ce qu’elles savent. Les femmes s’effacent. Les femmes reculent. La plupart des femmes ont été suffisamment dominées par les hommes – contrôle, violences, insultes, mépris – pour qu’aucune menace ne leur semble anodine.
Ce livre ne dit pas : pardonnez-moi et aimez-moi. Il ne dit pas : je vous pardonne, je vous aime. Il semble qu’une écrivaine ne peut prospérer (ou à tout le moins survivre) en ces temps difficiles qu’en distillant le pardon et l’amour en filigrane de son œuvre. Non. Je dis non.
Un homme peut-il lire ce livre ? Un homme peut-il lire un livre écrit par une femme où le langage n’est jamais décoratif ou joli ? Un homme peut-il lire un livre écrit par une femme où elle, l’autrice, exprime sans médiation un lien direct avec l’expérience, les idées, la littérature, la vie, y compris la baise, de façon à ce que son propos et son mode d’expression ne soient pas déterminés par les frontières qu’ont tracées les hommes pour cette femme ? Un homme peut-il lire une œuvre de femme s’il y trouve autre chose que ce qu’il sait déjà ? Un homme peut-il s’ouvrir à un défi qui interpelle non seulement sa domination, mais également sa cognition ? Et, pour parler clairement, est-ce que je dis en savoir plus que les hommes sur la baise ? <:br>Oui, je le dis. Ce n’est pas simplement autre chose : j’en sais plus et je le sais mieux, c’est une connaissance plus profonde et plus vaste, celle que toute personne exploitée a de son exploiteur.
Intercourse ne raconte pas mon vécu pour le mesurer à ceux de Norman Mailer ou de D. H. Lawrence. La voix de chaque auteur est intégrée à la construction même du livre. Je me sers de Tolstoï, Kôbô Abé, James Baldwin, Tennessee Williams, Isaac Bashevis Singer et Flaubert, non comme autorités mais comme exemples. Je les utilise ; je les entaille et les dissèque pour les exposer ; mais l’autorité fondatrice du livre, celle qui sous-tend chacun de ses choix, est la mienne. En termes formels, Intercourse est donc arrogant, froid et dénué de remords. Ce n’est pas moi, la fille, que vous allez examiner, mais eux. J’ai créé avec Intercourse un univers intellectuel et imaginatif où vous pouvez les observer. Le simple fait d’usurper leur place, de faire d’eux mes personnages, réduit l’autorité implicite associée non à leur art, mais à leur classe de sexe. J’adore la littérature que ces hommes ont créée, mais je ne vais pas vivre ma vie comme s’ils étaient réels et moi, non. Je ne tolérerai pas non plus le préjugé persistant selon lequel ils en sauraient plus sur les femmes que nous en savons sur nous-mêmes. Et je ne crois pas qu’ils en savent plus sur les rapports sexuels. Les habitudes de déférence peuvent être brisées, et c’est à nous de les briser. On peut refuser la soumission ; et je la refuse.
Bien sûr, des hommes ont lu et lisent encore Intercourse. Beaucoup aiment ce livre et le comprennent. Quelques-uns y ont pris un vif plaisir : il leur laisse entrevoir un nouvel espace de liberté, une nouvelle éthique sexuelle, et ils ne veulent pas être des exploiteurs. Certains hommes réagissent au radicalisme d’Intercourse : les idées, la prose, la structure, les questions qui sous-tendent et subvertissent délibérément le sens. Mais si le vécu sexuel d’un homme a toujours été, sans exception, fondé sur la domination, non seulement en actes explicites mais en a priori métaphysiques et ontologiques, comment peut-il lire ce livre ? La fin de la domination masculine signifierait, dans l’esprit d’un tel homme, la fin du sexe. Si l’on a érotisé un différentiel de pouvoir qui autorise la force comme naturelle et nécessaire au coït, comment comprendre que ce livre ne dit pas que tous les hommes sont des violeurs ou que tout coït est un viol ? L’égalité dans le domaine du sexe est une idée antisexuelle si la sexualité exige la domination pour être valide comme sensation. Aussi triste que je sois de le reconnaître, les limites du vieil Adam – et le pouvoir matériel qu’il conserve, surtout dans le monde de l’édition et des médias – ont imposé des limites au discours public (des hommes et des femmes) à propos de ce livre.
Les femmes sont généralement autorisées à dire oui ou non au coït, perçu comme synonyme du sexe, du sexe authentique. Dans cette version réductrice du meilleur des mondes, les femmes aiment le sexe ou ne l’aiment pas. Nous sommes loyales au sexe ou nous ne le sommes pas. Mais la gamme d’émotions et d’idées exprimées dans ces pages par Tolstoï et ses collègues est proprement interdite aux femmes contemporaines. Le remords, la tristesse, le désespoir, l’aliénation, l’obsession, la crainte, la rapacité, la haine – toutes émotions qu’expriment les hommes et particulièrement les artistes masculins – se réduisent pour les femmes à un simple vote négatif. Céder signifie oui ; un vivat simpliste signifie oui ; affirmer le droit implicite des hommes à baiser sans égard aux conséquences pour les femmes est un oui. Tenir tête à la force et à l’exploitation signifie non ; appuyer la pornographie et la prostitution signifie oui. « J’aime ça » est le critère de citoyenneté, et « j’en veux » épuise à peu près pour les femmes la portée du Premier amendement. Toute réflexion critique ou émotion profonde nous situe dans le camp des puritains, ce lieu d’exil halluciné où sont larguées les femmes exprimant des griefs, après quoi l’on peut nous abandonner. Pourquoi, socialement parlant, nourrir une femme que l’on ne peut pas baiser ? Pourquoi baiser une femme qui pourrait poser une question, voire posséder une vie émotive complexe ou une idée politique ? Je refuse de tolérer cette vision de serment d’allégeance que l’on applique aux femmes et au coït ou aux femmes et à la sexualité ou, plus précisément, aux femmes et aux hommes. La pression imposée aux femmes pour leur arracher un oui s’étend maintenant à des fillettes de treize ans, que menace un véritable goulag social si elles ne sont pas « hot », accommodantes et loyales ; elles encourent de plus en plus la violence d’adolescents pour qui le coït est un rapport d’appropriation. Le refus de laisser les femmes ressentir une gamme complète d’émotions, exprimer un large éventail d’idées, aborder leur vécu avec une honnêteté qui déplaît aux hommes, ou poser des questions qui déconcertent et contrarient les hommes dans leur domination, a eu pour simple effet de créer une nouvelle génération d’exploiteurs et de victimes – les enfants, garçons et filles respectivement. Les filles se retrouvent baisées, mais sans liberté ni égalité. Il est temps d’en prendre acte. Elles sont baisées ; elles sont battues ; elles sont violées – par des petits copains dès l’école secondaire.Intercourse veut transformer ce qui arrive à ces filles. Il pose au moins certaines bonnes questions. Il reflète la densité, la complexité et le sens politique de l’acte du coït : ce pourquoi des hommes, et maintenant des garçons, se sentent en droit d’investir l’intimité (privacy) du corps d’une femme dans un contexte d’inégalité. Intercourse pose ces questions sans égard aux frontières imposées aux femmes par les hommes. Il transgresse des limites dans ce qu’il dit et dans sa façon de le dire.
Pour moi, la recherche de la vérité et du changement par les mots constitue le sens même de l’écriture ; la prose, la réflexion, l’itinéraire sont sensuels et exigeants. J’ai toujours aimé l’écriture qui nous entraîne en profondeur, aussi étrange, amère ou salissante que soit la plongée. En tant qu’écrivaine, j’aime l’expérience de ressentir, de me souvenir, d’apprendre, d’interroger, de vouloir savoir et voir et dire. Intercourseest quête et assertion, passion et furie ; et sa forme mérite, tout autant que son contenu, l’attention critique et le respect.
édition : mars 2019